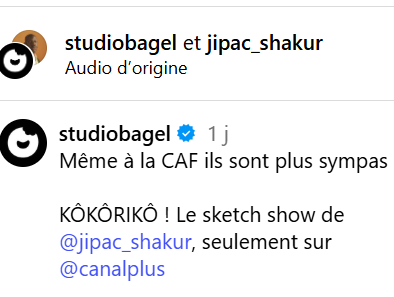Le récit sur l’esclavage à la française
“C’est impossible d’avoir une exactitude historique parfaite. C’est un sujet difficile à aborder, mais on va le faire parce qu’il faut que les gens sachent ce qui s’est passé. Mais faut faire rire parce que sinon les gens ne supporteront pas…”
Je me dis que c’est sûrement la base des discussions des cinéastes afrofrançais qui décident de créer sur la thématique de l’esclavage. Je trouve fascinant d’avoir la volonté de “rétablir la vérité”, de “parler de l’histoire qu’on ne nous apprend pas à l’école”, mais de continuer à proposer des récits déshumanisants, stéréotypés donc inutiles.
Depuis que je fais Karukerament, je constate que l’automne est la saison idéale pour le clickbait. Les “Antillais” et tout ce qui concerne “les Antilles” sont un sujet de choix pour faire le buzz. Cette semaine, j’ai vu une vidéo partagée par plusieurs pages auxquelles je suis abonnée sur Instagram. Co-publiée par Jean-Pascal Zadi et le Studio Bagel, elle s’intitule “L’administration française à l’ancienne”... Aux côtés de l’humoriste Fary Lopes, il incarne un “esclave affranchi” demandant à une juge des indemnités le lendemain de l’abolition de l’esclavage de 1848. La juge leur explique que seuls les maîtres recevront une indemnisation. Bien que les commentaires Instagram soient élogieux, personne ne questionne l’intention de publier cet extrait avec pour légende “même à la CAF ils sont plus sympas”...
Capture de la page IG de Jean-Pascal Zadi - le 11 octobre 2025
En effet, cette capsule, lue avec la grille Karukerament, entretient le flou sur l’histoire de l’esclavage comme le cinéma français encourage à le faire alors que la véritable originalité se trouve dans la version longue intitulée “Le Jour d’après” disponible depuis juillet 2023 sur la chaîne Youtube de Studio Bagel. La majorité du sketch étant conventionnelle, j’avais décidé de ne pas en parler à l’époque. Néanmoins, quand je vois que cet extrait cumule plus de 39 mille likes en 24 heures avec des félicitations et des remerciements de mettre en lumière un fait “inconnu”, je me dis qu’il est important de garder une trace sur la façon dont on peut manipuler le récit sur l’esclavage sous couvert de transmettre une histoire qui soi-disant est gardée dans l’ombre. Avec la grille Karukerament, je vous propose une analyse succincte comparative entre la version courte Instagram et la version longue Youtube.
La version Instagram avec le regard Karukerament
La contextualisation temporelle : de quelle abolition parle-t-on ? L’abolition de 1848 n’est pas l’abolition de 1794. Le contexte politique n’est pas le même. Nous sommes dans le flou.
La contextualisation géographique : où se déroule la scène ? Dans un tribunal (?) à Paris, aux colonies ? Ou dans une ville comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle ? Nous sommes dans le flou.
L’humanisation des Noirs : que signifie être affranchi avant 1848 ? Que signifie être affranchi après 1848 ? Est-ce que ce sont des Noirs de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion ? En tout cas, Jean-Pascal Zadi et Fary Lopes interprètent des personnages anonymes, sans famille, sans aucun élément pour les caractériser donc toujours ce concept d’un peuple noir monolithique. Nous sommes dans le flou. Par contre, comme dans Case Départ (article de blog), le duo fonctionne sur le stéréotype du Noir peau foncée un peu brute, géré par sa colère (légitime) et du Noir peau claire plus calme, plus civilisé.
L’humanisation des Blancs : aucun maître Blanc n’est montré. Aucune maîtresse blanche n’est montrée. La justice (?) est incarnée par une femme blanche qui rappelle son humanité par rapport à sa difficulté de devoir gérer la rivalité Lyon - Saint-Etienne. Nous sommes dans le flou.
Les dynamiques de pouvoir : la violence physique est suggérée. La juge est toujours assise en position dominante par rapport aux deux affranchis bien qu’ils soient debout. Aucune mention des résistances, des révoltes.
Donc concrètement, qu’il y ait un public qui trouve ça drôle, je le conçois tout à fait. Et je conçois même la contradiction que ce public soit le même qui critique négativement Case Départ. Par contre, que cette vidéo reçoive des compliments pour sa subtilité d’écriture, pour le fait d’être quasiment un documentaire, je ne comprends pas… Pardon, il faut doser.
La version Youtube avec le regard Karukerament
La contextualisation temporelle : la scène se déroule le 28 avril 1848 soit le lendemain de la publication officielle de la seconde abolition de l’esclavage. C’est une originalité de représentation.
La contextualisation géographique : chaque colonie a une date d’abolition différente. Le carton du début annonce que la scène se passe en France. La date permet de supposer que cela se passe dans la France hexagonale. C’est une originalité de représentation.
L’humanisation des Noirs : ce sont des affranchis de la seconde abolition sans qu’on comprenne ce que ce statut représente avec ou sans indemnité, sans qu’on comprenne ce que ce statut représente pour un Noir dans les colonies ou dans l’Hexagone. A priori, vu leur façon de parler, ils sont des affranchis de l’Hexagone qui étaient des domestiques et pas des militaires. Ils prennent directement la parole pour plaider leur cause sans passer par un porte-parole. C’est une originalité de représentation.
L’humanisation des Blancs : la séquence s’ouvre sur un dialogue avec un maître Blanc recevant ses indemnités. Il déplore le fait de devoir verser un salaire à ses anciens esclaves mais se réjouit de leur faire payer un loyer… Si le but était de dénoncer l’injustice du système envers les Noirs en faisant rire, les trente premières secondes du sketch étaient largement suffisantes. L’humour aurait dû venir du fait de contester directement la cruauté de ces propos énoncés sur un ton bon enfant au lieu de décaler le moment pour que le maître Blanc puisse quitter tranquillement la scène. Les vingt dernières secondes où l’assistant du juge sort une phrase en “créole” pour leur demander de partir illustre la dévalorisation traditionnelle de nos langues régionales que nous avons l’habitude de dénoncer. C’est une originalité de représentation.
Les dynamiques de pouvoir : ils sont les seuls Noirs de la pièce et sont placés au centre. Tous les autres personnages sont Blancs mais les deux Noirs ne sont pas physiquement relégués à l’arrière-plan. Leur tenue permet de comprendre qu’ils ne font pas partie de la bourgeoisie. Bien qu’ils ne mènent pas l’échange, ils sont filmés sans les mettre en position d’infériorité. Cela reste une originalité de représentation… qui est annulée par le fait que la juge et son assistant ont le dernier mot et sont la dernière image de la vidéo.
un cadre français à connaître
A ce jour, la vidéo Youtube a plus de 900 000 vues. Certains s’étonnent qu’un tel sketch soit disponible sur Canal+ alors que c’est un récit conventionnel qui ne nuance ni ne remet en cause le système de représentation français. Je ne dis pas que ce sketch aurait dû avoir une visée éducative. Je dis qu’il ne faut pas projeter cette intention quand le résultat n’a objectivement aucun élément pour le faire. Et si on me rétorque que mon analyse est trop sérieuse, cela va exactement dans le sens de ce que j’avance sur le fait que ce sketch n’est vraiment pas la hot take pour lequel on veut le faire passer.
Il est possible de distiller de l’humour dans la représentation de l’esclavage, mais cela ne fonctionne que si le système est tourné en ridicule et pas simplement juste décrit tel qu’il est… Je ne crois pas que le public français ait besoin de rire pour discuter du sujet, mais il est évident qu’il faut un certain degré de pédagogie pour que le récit ne soit pas ennuyeux. Il est difficile de trouver un équilibre entre transmettre une perspective réaliste de l’époque esclavagiste sans traumatiser le public noir et le public blanc et divertir. C’est d’ailleurs peut-être ce qui manque à Sucre Amer de Christian Lara qui, je pense, est trop souvent analysé (et critiqué) sous l’angle du divertissement et pas suffisamment valorisé pour sa représentation de l’histoire et de l’évolution de la société guadeloupéenne française entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Ce cinéaste a posé un cadre dans la représentation des résistances avec les personnages de Delgrès (Luc Saint-Eloy) et Ignace (Jean-Michel Martial). Dans Tropiques Amers, Jean-Claude Barny a posé un cadre dans la représentation du quotidien du point des esclavisés martiniquais avec le personnage d’Adèle (Fatou N’Diaye) en 2007. De même, dans les Mariés de l’Isle Bourbon, Euzhan Palcy a posé un cadre pour représenter la noblesse métissée française avec le personnage de Jean (William Nadylam). Dans le film d’animation Battledream Chronicle (2015), Alain Bidard a posé un cadre pour représenter les dangers d’un esclavagisme globalisé avec le personnage de Syanna. Dans le court-métrage Ici s’achève le monde connu (2022), Anne-Sophie Nanki a posé un cadre pour représenter la mise en place du système esclavagiste du point de vue des Kalinagos et des Africains déportés… Comme je l’avais évoqué avec le Dr. Dexter Gabriel, la filmographie mondiale sur le sujet représente une vision très limitée de toutes les histoires qu’on pourrait raconter sans trauma porn. Représenter l’esclavagisme, c’est tellement plus que d’esthétiser la souffrance physique. L’enjeu est aussi de valoriser le mécanisme de réhumanisation. C’est le concept de démounaj/remounaj de l’artiste guadeloupéen Lukuber Séjor qui est exploré par des artistes millenials comme Célia Wa.
Pourtant, les médias, les critiques et les réseaux sociaux continuent d’utiliser la mise en scène de la souffrance comme l’unique critère de qualité d’un récit sur l’esclavage… Ma génération de millenials persiste dans cette idée que l’école est l’unique responsable de la méconnaissance de l’histoire de l’esclavage alors que… non ? Nous sommes la première génération ayant eu un accès facile aux travaux de vulgarisation des historien.ne.s. Nous sommes la première génération ayant une base d’oeuvres audiovisuelles françaises à analyser. Qu’on ne soit pas prêt psychologiquement à approfondir ses connaissances sur le sujet, c’est tout à fait compréhensible… Mais pourquoi ressentir ce sentiment de honte voire de mépris pour les personnes de l’époque qui se sont battus pour survivre ? Je pense qu’il est important de s’interroger sur notre regard actuel sur cette période quand ce sketch ou des longs-métrages comme Ni Chaîne Ni Maître (2024), Furcy né libre (2026)* sont présentés comme une représentation originale alors qu’il s’agit du recyclage de la vision attendue avec plus ou moins de sensationnalisme.
A l’instar du dernier clip-vidéo de Misié Sadik à la cinématographie irréprochable et aux romans guadeloupéens récents que j’ai lus sur cette thématique (épisode sur le Chant des fromagers, épisode sur Karukera, les légendes de Kaïa), je trouve quand même inquiétant que nous n’arrivions pas à imaginer la mise en place des lignées qui expliquent l’existence du peuple guadeloupéen actuel. Oui, des millions de femmes, d’enfants et d’hommes sont morts à cette époque, mais d’autres ont survécu. Connaissez-vous réellement leurs histoires ?
Comme je l’avais souligné dans le documentaire Aux origines, l’esclavage (écoute l’épisode), c’est à chacun de questionner son regard sur cette période historique. Pourquoi les productions faites par les concernés sont-elles au mieux négligées au pire méprisés ? Pourquoi les Afrofrançais concernés indirectement par le sujet ne questionnent-ils pas leur filtre colonial ? Tant qu’on est incapable de voir les concernés comme des êtres humains dans leur complexité, tant qu’on veut juste les voir comme des corps souffrants, tant qu’on a du mal à concevoir que ces êtres humains ont gardé une autonomie de penser malgré le statut d’esclave, quelle est l’utilité d’avoir une connaissance encyclopédique ?
Oui, il y a des histoires à raconter sur les libres de couleur, sur les affranchis avant 1848 et sur les sociétés post-1848 qui ont une bonne situation financière sans nécessairement les présenter comme des traitres “à la cause”. Il y a aussi les vagues d’immigration asiatiques à raconter… “Antillais” n’est pas synonyme de Noir. En 2025, il est plus que le temps que tout le monde intègre cette réalité.
Après les travaux de Jean-Pierre Sainton dans les années 90, les travaux de Myriam Cottias et Frédéric Régent dans les années 2000, les travaux de Silyane Larcher, Jessica Pierre-Louis ou encore Julie Duprat nous accompagnent aussi depuis les années 2010 pour enrichir le récit français sur l’esclavage, comprendre la société de l’époque et notre société contemporaine. Peut-être que dans une dizaine d’années, il ne s’agira plus juste de représenter les tortures dans les habitations, mais bien comment construire des communautés culturelles dans le système (post)esclavagiste.
*Je n’ai pas encore vu Furcy né libre mais les interviews d’Abd El Malik et les photos disponibles à ce jour ne me donnent pas l’impression que ce sera un récit original. Cela n’empêche pas que cela peut être un beau récit.
N.B: il y a plein d’autres historien.ne.s qui travaillent sur le sujet. Je vous ai donné le nom de ceux qui me paraissent des incontournables quand on ne sait pas par où commencer et qu’on préfère les contenus numériques parce que les contenus papier peuvent être intimidants.